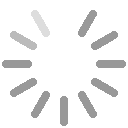Une (brève) carrière à ciel ouvert
A l’ouest du château, près de la ligne de crête, on découvre une carrière à ciel ouvert creusée dans le calcaire dur. Cette carrière fut ouverte pour l’extraction des blocs massifs utilisés lors de la première campagne de modernisation des défenses au début du XVIIe siècle.
La pierre du Pic Saint-Loup, un calcaire bioclastique à chaille, est le premier matériau disponible sur place. Elle va être utilisée de différentes manières, du XIe au XVIIe siècle, témoin de l’évolution architecturale du château.
Dans les premières périodes du château, la pierre est taillée en petits calibres soignés et appareillés de manière régulière dans les murs. Au XIIe siècle en effet, le rôle du château est avant tout ostentatoire : ce nid d’aigle en surplomb affirme le pouvoir du comte de Melgueil sur la région. Les pierres ayant servi à édifier les premiers bâtiments de Montferrand sont vraisemblablement ramassées et taillées sur place, dans les nombreux clapas entourant le château, ou extraites à proximité immédiate de la zone de construction.
Au XIIIe siècle, l’usage du grès, présent dans la vallée, se généralise lors des travaux d’agrandissement et de fortification du château entamés par Raymond VI de Toulouse. Si le lieu d’extraction est plus éloigné du chantier, la roche présente l’avantage d’être plus tendre, donc plus facile à travailler, que le calcaire dur.
Toutefois, au fil du temps, les techniques de construction évoluent, signe de l’appauvrissement des évêques-comtes : à la fin du Moyen Age, les murs du château sont généralement plus grossiers et construits en moellons.
Quand les pierres du clapas ne suffisent plus...
L’ouverture de la carrière au début du XVIIe siècle répond aux contraintes du projet de militarisation du site. En effet, la construction bastionnée en grand appareil de taille requiert une importante quantité de blocs de pierre, à la fois gros et réguliers. Or, les clapas et les pierres de surface ne peuvent pas fournir de blocs assez volumineux pour le système fortifié moderne.
Pour l’extraction des pierres, les carriers mettent à profit les nombreuses veines de calcite présentes dans la roche : d’une dureté différente du calcaire, elles sont utilisées pour écarter les blocs grâce à des leviers. Une tête de masse retrouvée sur place et des traces caractéristiques sur la paroi rocheuse témoignent de l’utilisation de chante-perce, une tige en métal servant à faire des avant-trous dans la roche. Les blocs décrochés du front de taille sont basculés vers l’intérieur et débités en blocs plus petits. Ces blocs bruts sont ensuite acheminés vers la zone de construction où ils sont taillés puis maçonnés. Les chutes, quant à elles, sont entassées au sud, dans le cône de déblais. L’extraction est d’autant plus aisée que les lits naturels sont situés le long de la crête, à la même altitude que le château : le transport en est facilité.
Après l’abandon des grands travaux de fortification en 1622, la carrière est peu à peu transformée en potager pour nourrir la garnison encore stationnée au château. C’est d’ailleurs sous cet usage « d’espace servant de jardin », gardé par une porte à claire-voie, qu’elle est décrite dans l’expertise du château réalisée en 1677.
Dans la série
Le long des sentiers
Lorsque vous marchez le long du chemin de grande randonnée GR60 au départ de Saint-Mathieu-de-Tréviers...
Une (brève) carrière à ciel ouvert
A l'ouest du château, près de la ligne de crête, on découvre une carrière à ciel ouvert...
Les fours à chaux
Les vestiges d'au moins 5 fours à chaux sont visibles dans un rayon de 500 m autour du château...
Au pied du château : un enclos
À Montferrand, un vaste enclos ceint d'un mur en pierre sèche est repérable à une quinzaine de mètres...