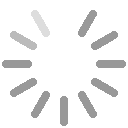XVIIe siècle Derniers assauts
1604 - Début des travaux de fortification
Les évêques Jean Garnier puis Pierre Fenouillet entreprennent d’ambitieux travaux d’amélioration de l’habitat et de modernisation des systèmes de défense du château. Il est également prévu de l’équiper de pièces d’artillerie. L’architecture du château est alors intégralement repensée, ouvrant la 3e grande phase de restructuration du site.
Les travaux sont supervisés par Jean de Ratte, gendre d'Antoine de Cambous et père de Guitard de Ratte, évêque de Montpellier de 1597 à 1602. Au début du XVIIe siècle, la famille de Ratte joue un rôle prépondérant dans le château. Le blason familial surmonté par les attributs comtaux et épiscopaux a d’ailleurs été retrouvé sur une pierre d’embrasure dans le château.
1610 - Fortification tenaillée moderne
Après l’assassinat d’Henri IV, qui avait promulgué l’Edit de Nantes (1598) protégeant la liberté de culte, la régence de Marie de Médicis puis le règne du roi catholique Louis XIII ravivent les tensions, notamment à Montpellier, restée protestante.
Peu après 1610, l’évêque Pierre Fenouillet reprend directement en main la forteresse après quelques démêlés juridiques avec Antoine de Ratte, héritier des Cambous. D'importants travaux de modernisation des fortifications sont entrepris entre 1610 et 1622 mais demeurent inachevés : queue d'hironde, portes, ravelins, remparts tenaillés... Une carrière est ouverte pour l'occasion à l'ouest du site.
1622 - Les troupes du duc de Rohan assiègent Montferrand
La ville de Montpellier refuse de reconnaître l'autorité de Louis XIII. Les tensions s’intensifient entre catholiques et protestants. L'évêque-comte Pierre Fenouillet se retranche à Montferrand avec une garnison de près de 200 soldats. Une fortification d'urgence est alors mise en place : parapets en moellon, terre-pleins de renforcement, gabions...
Alors que le roi de France s'apprête à assiéger Montpellier, les troupes du duc protestant Henry de Rohan font mouvement depuis les Cévennes pour rejoindre la ville. Places fortes et villages du comté tombent un à un. Après plusieurs escarmouches, les insurgés décident d'assiéger la forteresse : trois jours plus tard, submergés par les tirs d’artillerie, les assaillants doivent se replier dans la vallée.
A la fin de la même année, la ville de Montpellier se rend aux armées du roi après un mois de siège.
En récompense, Jacques de Valat, l’officier qui s’est distingué lors de la prise de Montpellier, est nommé châtelain à vie de la forteresse conjointement par l’évêque-comte Pierre Fenouillet et le roi de France. La forteresse conserve une garnison de 60 hommes.
1659 - Mort de Jacques de Valat, dernier châtelain de Montferrand
En 1659, lorsque Jacques de Valat, dernier châtelain de Montferrand, meurt après 35 ans de service, la forteresse a perdu toute utilité économique et stratégique : le territoire est désormais sécurisé, organisé dans les vallées autour de villages devenus les nouveaux foyers de peuplement. Au c½ur du royaume de France enfin apaisé, le titre de comte de Melgueil et de Montferrand est devenu un titre purement honorifique.
1677 - Expertises de réparation
A la mort de l’évêque-comte François du Bosquet, un inventaire de l’édifice est commandé à deux architectes, Esprit Dumas et Georges Espinassou, en vue d'une réparation du château. Leur rapport, conservé aujourd’hui aux Archives départementales de l’Hérault, fait état d’un entretien limité du lieu. L’édifice, inoccupé, est vide : les toitures prennent l'eau, certains dallages sont rompus, les menuiseries à revoir ou à remplacer.
1699 - Autorisation de démolition
Vingt ans plus tard, une seconde expertise relève qu’aucune réparation n’a été faite.
Planchers et toitures sont dans un état de délabrement avancé ou se sont effondrés. La conclusion de l’expert est sans appel : "Comme ledit château n’est d’aucune utillité présentement et qu’il faudroit pour le rebâtir et réparer de grosses dépenses, et principalement pour l’entretien et la garde d’icelluy, nous ne faisons aucune estimation pour ledites réfections et réparations comme estant inutiles".
A la requête de l’évêque Charles-Joachim Colbert de Croissy, Louis XIV autorise la démolition du château : au mauvais état de celui-ci s’ajoute la crainte qu’il ne puisse servir de refuge à d’éventuels insurgés aux portes des Cévennes.
Châtelains
de Montferrand
• Jean de Ratte - 1604, sire de Cambous, gendre d'Antoine de Cambous, précédent châtelain
• Pierre Fenouillet - 1610, évêque-comte de Melgueil-Montferrand
• Jacques de Valat - 1623-1659, châtelain à vie, dernier châtelain de Montferrand
Comtes
de Melgueil
Comtes-évêques
• Guitard de Ratte - 1596-1602
• Jean Garnier - 1603-1607
• Pierre Fenouillet - 1608-1652
• Renaud d'Este - 1653-1655
• François de Bosquet - 1655-1676
• Charles de Pradel - 1676-1696
• Charles-Joachim Colbert de Croissy - 1696-1738