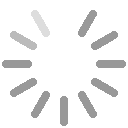Le château de la Roquette, voisin et rival
Quelle surprise de voir se dresser sur la crête de l’Hortus, en face du château de Montferrand, l’élégante silhouette d'une autre forteresse : c'est celle du château de la Roquette, qu'on appelle aussi Viviourès, qui semble défier le premier.
De défi, il en est bien question puisque les relations entre les deux forteresses ont souvent été orageuses. Et pour cause : l'une appartient au comte de Melgueil, l'autre dépend du roi de France. Aujourd'hui toutes deux ruinées, à l'écart du temps, elles témoignent pourtant de l’histoire mouvementée du comté de Melgueil et de la stratégie de domination du Languedoc par le roi de France.
Un peu d'histoire
La première mention du château de la Roquette remonte à 1124 dans le Cartulaire des Guilhem de Montpellier. Le château est alors au c½ur d’un conflit opposant Guilhem VI et le comte Bernard de Melgueil. Plusieurs seigneurs locaux, dont celui de Montpellier et ceux du château de la Roquette, les frères d’Airre, ont envahi le causse de l’Hortus, possession comtale. Le comte Bernard, leur suzerain, fait saisir le château, écrête les défenses et en abat le donjon : il le rend six ans plus tard à ses propriétaires avec interdiction formelle de reconstruire les parties démolies.
En 1236, la famille d’Airre se rebelle à nouveau contre son suzerain, qui est désormais l’évêque de Maguelone, dont elle refuse l’autorité. Soutenue par plusieurs seigneurs locaux et des consuls de Montpellier, elle envahit les terres épiscopales et cause de nombreux dommages : alerté par l’évêque, le pape intervient, menaçant d’excommunication les fauteurs de trouble.
Quelques années plus tard, un événement fait basculer le destin de ce petit castrum sans défense : en 1240, la fille du seigneur d’Airre, Béatrix, épouse Guillaume de Pian, bailli du Gévaudan et futur sénéchal de Carcassonne (1249) au service du roi de France. Dès lors, le château de la Roquette va entrer pleinement dans la stratégie de domination du pouvoir royal sur le Languedoc, et plus particulièrement sur le comté de Melgueil.
Une architecture symbolique...
Dès le milieu du XIIIe siècle, sous l’impulsion de Guillaume de Pian, le castrum se mue progressivement en château royal, sur le modèle de la cité de Carcassonne et de Peyrepertuse, dont il dirige les travaux de fortification. L’architecture de la Roquette est d’ailleurs fortement inspirée de ces constructions.
Ancré sur son éperon rocheux, ce vaisseau long de 50 m sur 9 m de large se dote d’une grande salle monumentale de 100 m2 couverte d’une voûte en berceau brisé de 7 m de haut. Ce vaste espace cloisonné regroupe de nombreux usages : exercice du pouvoir, cuisine avec citerne, cheminée monumentale pour le chauffage… Les ouvertures, agrémentées de coussièges (bancs dans l’embrasure de la fenêtre) sont larges et nombreuses. Corniches et chapiteaux ajoutent encore au décor d’apparat et au faste, tranchant avec les constructions austères et sombres de l’aristocratie locale.
… sans efficacité réelle
A la Roquette, l’effet de puissance est avant tout symbolique. Les principes de construction ne visent pas l’efficacité dans la défense, contrairement à Montferrand, fortifié quelques années plus tôt. On ne trouve ici aucun ouvrage défensif caractéristique de l’époque : flanquement, bretêche, herse, assommoir… Les nombreuses ouvertures ménagées dans les murs ne sont pas protégées. Le seul élément de défense active propre à l’architecture de Philippe Auguste, est une échauguette : mais ses proportions démesurées et le fait qu’elle soit remplie de maçonnerie la rendent inutilisable.
Certes, le château, avec son positionnement, assure une protection suffisante face aux bandits de grand chemin, mais il ne saurait repousser une armée structurée et équipée pour organiser un siège. Véritable mise en scène du pouvoir royal, la forteresse affiche un vocabulaire monumental mais sans réel souci d’efficacité défensive.
Deux pouvoirs en place
L’effet de puissance de la Roquette est avant tout symbolique : en 1215, les évêques de Maguelone ont repris le gigantesque chantier de requalification du château comtal initié par le comte de Toulouse. Cet édifice démesuré, très au-dessus de leurs moyens, leur permet d’affirmer leur autorité face à des vassaux indociles, comme le roi d’Aragon, nouveau seigneur de Montpellier, et à des voisins dangereux, comme le roi de France qui souhaite par tous les moyens étendre son territoire jusqu’à la mer.
Le château de la Roquette apparaît comme la réponse de ce dernier au défi épiscopal : la situation est d’autant plus complexe que le seigneur de la Roquette est à la fois vassal de l’évêque et officier royal. Des conflits éclatent régulièrement tout au long du XIIIe siècle, les troupes royales multipliant les incursions sur les terres comtales. Le pape multiplie les plaintes auprès du roi de France qui ne se hâte pas de ramener l’ordre.
Au fil du temps, les tensions s’apaisent : alors que l’évêque fait face à l’hostilité du puissant roi Jacques d’Aragon, son vassal pour la seigneurie de Montpellier, le roi de France change de stratégie et se pose en protecteur du prélat. Ce revirement est peut-être lié au fait que dès les années 1250, le roi est parvenu à contourner le comté de Melgueil pour accéder à la Méditerranée. En achetant des terres à l’abbaye de Psalmody (Saint-Laurent-d’Aigouze), il peut enfin construire un nouveau port qui lui permet de s’affranchir de la coûteuse flotte des navires italiens : Aigues-Mortes.
En 1302, l’évêque autorise le seigneur de la Roquette à construire de nouvelles fortifications autour du château, dont une enceinte basse ponctuée d’archères.
La fin du château
En 1416, Marie de Pian prête un dernier hommage à l’évêque pour le château et ses possessions. Puis le château change de mains à plusieurs reprises. Au milieu du XVIe siècle, il devient la propriété de Fulcrand de Roquefeuil, futur gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi : mais celui-ci l’abandonne bientôt au profit d’une nouvelle résidence au Mas-de-Londres, plus confortable et offrant tout le luxe de la Renaissance.
Un siècle avant Montferrand, le château de la Roquette a perdu toute utilité stratégique, le roi de France et l’évêque de Maguelone ayant fait définitivement la paix, désormais unis face au péril protestant. Son nom s’efface aussi des mémoires au profit de Viviourès (Bibieures) qui est celui d’une ferme située en contrebas.