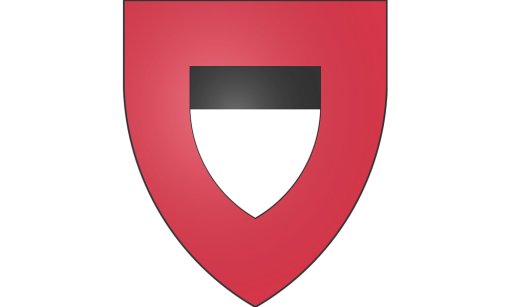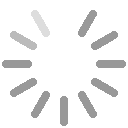Bertrand Pelet de Melgueil
Un héritier victime de son arrogance et de l'injustice du pape
Bertrand Pelet de Melgueil est une figure atypique de l’histoire du comté : victime de son ambition, il est déshérité par sa mère au profit de sa s½ur cadette qui lègue l’héritage familial aux comtes de Toulouse. S’ensuit une longue guerre de succession, nourrie d’injustice et d’entêtement, dont sauront tirer profit le pape et le roi de France, au détriment des héritiers légitimes.
Né vers 1146, Bertrand est, avec sa s½ur cadette Ermessende, le fruit du second mariage de Béatrix de Melgueil avec Bernard Pelet, seigneur d’Alès. Il a un frère aîné, Raimond-Bérenger III, né du premier mariage de sa mère avec le comte de Provence, qui a eu lui-même une fille, Douce, née vers 1162.
Un héritier arrogant
A la mort de Bernard Pelet en 1170 se pose le problème de la transmission du comté de Melgueil, dont une partie doit revenir à Douce, la petite-fille de Béatrix.
Bertrand refuse le partage, étant le seul héritier mâle : il commence à porter indûment le titre de comte de Melgueil (comme l’avait fait son père lui-même), alors que seule sa mère, encore vivante, en est détentrice. Il obtient le soutien de Guilhem VII de Montpellier, son grand-oncle, qui ne peut que tirer avantage de ces dissensions familiales. Outrée par le comportement de son fils, Béatrix le déshérite au profit de sa fille Ermessende, qui vient d’épouser Pierre Bermond IV d'Anduze, et de sa petite-fille Douce, âgée de 4 ans, promise en mariage au fils du comte de Toulouse.
En 1172, Raymond V de Toulouse reçoit donc, par sa future belle-fille, la moitié du comté de Melgueil tandis que Pierre Bermond de Sauve reçoit l’autre partie, au nom de sa femme Ermessende, à la charge de le tenir en fief du comte de Toulouse. Mais Raymond V se conduit rapidement en souverain dans son nouveau territoire, assurant sa protection au seigneur de Montpellier en sa qualité de comte de Melgueil et de Montferrand et en statuant librement sur le poids et l’aloi des deniers frappés dans le comté. Et le seigneur de Montpellier s’empresse de lui rendre hommage, prenant ainsi ses distances avec Bertrand Pelet.
Mais Pierre Bermond meurt peu après. Béatrix décide alors d’offrir au puissant héritier de Toulouse non plus la main de sa petite-fille mais celle de sa fille Ermessende. En décembre 1172, Béatrix confirme la donation de la moitié du comté de Melgueil en sa faveur, l’autre moitié restant à la disposition de sa fille. Lorsqu’elle meurt quatre ans plus tard, sans descendance, Ermessende lègue sa part du comté de Melgueil et ses autres domaines à son mari : le territoire de Melgueil tombe définitivement aux mains de la maison de Toulouse.
Le pape, juge et partie
Bertrand Pelet tente par tous les moyens de récupérer ce qu’il estime lui revenir : il n’hésite pas à se rapprocher du roi Alphonse II d’Aragon, rival historique de la maison de Toulouse, pour obtenir son aide. En vain. Refusant de céder, il entre en guerre. Raymond V doit récupérer le comté par la force : il assiège les places principales, dont Montferrand, et les reprend sans peine.
Bertrand Pelet meurt en 1198 sans avoir obtenu gain de cause. Lorsqu’en 1209, le comté est confisqué au comte de Toulouse par le pape, son fils Raimond II Pelet (1175-1227) présente une requête au pontife. Une enquête conclut que Raimond n’est pas en mesure de prouver ses droits : plus grave encore, la redevance annuelle d’une once d’or due au Saint-Siège, selon les termes de la donation de 1085, n’a été payée depuis plus de 40 ans, non seulement par les comtes de Toulouse, mais par sa grand-mère Béatrix elle-même. Selon le droit féodal, le fief est « tombé en commise », ce qui entraîne sa confiscation.
Pour écarter toute nouvelle revendication des comtes de Toulouse ou de la famille Pelet, le pape choisit d’inféoder le comté à l’évêque de Maguelone. Juge et partie, le pape fait aussi une belle opération financière : car la transaction rapporte au trésor pontifical une somme astronomique, causant du même coup un endettement massif aux conséquences fâcheuses pour l’évêché.
Abandonné par le pape, Raimond Pelet doit se tourner vers un allié plus impartial.
A la même époque, le roi de France profite de la disgrâce du comte de Toulouse pour tenter d’annexer le Languedoc. En 1226, Humbert V de Beaujeu est désigné gouverneur du Languedoc : la province est partagée en deux sénéchaussées, celle de Beaucaire à l’est et celle de Carcassonne à l’ouest. Dès lors, les représentants de l’autorité royale n’ont de cesse de saper l’autorité du pouvoir comtal. L’évêque se plaint régulièrement au pape des empiètements des officiers royaux sur sa juridiction.
Mais il a d‘autant plus de mal à faire respecter ses droits qu’il n’est pas en possession des actes prouvant sa bonne foi. Et pour cause : la plupart des documents relatifs au comté est aux mains de Raimond Pelet. Le pape a beau ordonner, la famille n’acceptera jamais de les rendre, sanctionnant l’inféodation du comté aux évêques, tout comme elle avait dénoncé la mainmise du comte de Toulouse.
Un comté aux frontières fragilisées
Cet entêtement a de graves conséquences pour le comté : sans acte irréfutable, le pape ne peut pas faire valoir ses droits sur un territoire aux frontières rendues floues par méconnaissance, à l’administration devenue chaotique faute de contrats explicites et aux liens de vassalité qui se distendent lorsqu’ils ne sont plus entretenus.
Entre 1229 et 1236, le comté est envahi à plusieurs reprises par les armées du roi de France qui profitent des tensions entre l’évêque et le roi Jacques d’Aragon, nouveau seigneur de Montpellier. Plusieurs châteaux sont occupés, tels ceux de Laroque et de Montlaur. Les péages de Sainte-Croix et Fontanès sont confisqués. A force de plaintes et de menaces, le pape parvient à faire reculer le très catholique roi Louis IX, mais il n’est pas en mesure de légitimer ses droits sur plusieurs territoires. C’est le cas du riche Pays d’Hierle (Le Vigan), ancien fief minier de Pierre Bermond de Sauve, que l’évêque réclame en vain. La situation est cocasse dans la baronnie de Montredon (Sommières), sur laquelle le comté de Melgueil aurait des droits : les communes de Galargues, Campagne et Buzignargues continuent de faire partie du diocèse de Maguelone, alors que la baronnie dont elles dépendent échappe à l’évêque-comte. De même, la baronnie de Lunel, qui a appartenu à Bernard d’Anduze, est l’objet d’un litige dont le roi de France Philippe le Bel profitera sans mal…
Vers 1250, pour saper encore l'autorité comtale, le château royal de la Roquette est construit en face de celui de Montferrand par le sénéchal de Carcassonne Guillaume de Pian.
En 1265, redoutant que la famille Pelet ne se tourne vers le roi de France pour faire reconnaître ses droits, le pape demande à l’évêque Béranger de Frédol de céder à celle-ci un fief au revenu de 40 livres melgoriennes par an. Jugeant l’offre insatisfaisante, Pierre Pelet s’en remet à Saint-Louis qui convient que son aïeul a été lésé par l’inféodation de 1215. Sans nier l’injustice, le pape demeure inflexible, rappelant la commise du comté.
Ce n’est qu’en 1276 que les frères Pierre et Bertrand Pelet acceptent de signer un acte de renonciation définitive à leurs prétentions sur le comté, en échange d’une somme de 1000 livres tournois. Cet accord met fin à cent ans de guerre de succession pour le comté de Melgueil mais laisse un territoire rogné de toutes parts, plus fragile et plus endetté que jamais.