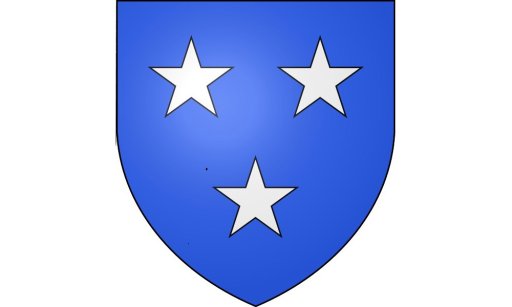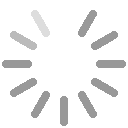Guitard de Ratte
Comte de Melgueil et de Montferrand, évêque de Montpellier de 1596 à 1602
Successeur d'Antoine de Subiet-Cardot à la tête de l'évêché de Montpellier, Guitard de Ratte n’a eu de cesse, durant son court épiscopat, de défendre sa foi au péril de sa vie.
Guitard de Ratte naît à Montpellier en 1552 dans une famille de magistrats : son père, Jean de Ratte, est lieutenant du viguier de Gignac puis avocat du roi au présidial de Montpellier. Sa mère, Marguerite de Cambous, est l’héritière du baron Antoine de Cambous, un fervent catholique qui s’illustre en 1584 en reprenant le château de Montferrand aux protestants.
Après avoir embrassé l’état ecclésiastique, il étudie le droit et obtient une charge de conseiller au parlement de Toulouse. Là, il devient un proche du président Jean-Étienne Duranti et de l’avocat général Jacques Daffis, fervents défenseurs du parti catholique.
Conseiller au parlement de Toulouse
En février 1589, une mission à Paris auprès du roi lui sauve la vie. En effet, au même moment, les Réformés, indignés par l’assassinat du duc de Guise quelques semaines plus tôt, se soulèvent à Toulouse : ils assassinent sauvagement Duranti et Daffis, condamnent le conseiller à mort par contumace et mettent à sac sa demeure.
Parvenu au trône, Henri IV indemnise Guitard de Ratte de ses pertes : il lui accorde une pension à vie de 12 000 livres et le fait nommer abbé de Saint-Sauveur de Lodève. Il le charge en outre d'une mission en Normandie auprès du gouverneur de la province, Gaspard Pelet de La Vérune, son parent, pour s’assurer de la fidélité de la région. A son retour, l’abbé est emprisonné par les Ligueurs mais délivré par le roi qui le nomme aumônier de l’abbaye de Saint-Chinian.
Evêque de Montpellier
En juillet 1596, l’évêque de Montpellier Antoine de Subiet-Cardot se démet de l’évêché en faveur de Guitard de Ratte. Celui-ci revient alors à Montpellier et s'efforce d’y résider malgré l'hostilité de la majorité de la population. Les chanoines se sont réfugiés depuis plusieurs années à Frontignan, lui-même change régulièrement de lieu de résidence, trouvant refuge au château de Montferrand : en témoigne la pierre gravée de son blason "D'azur à trois étoiles d'argent" surmonté d’une couronne de comte et de la crosse épiscopale, retrouvée au pied de la chambre dite "de l'évêque".
En 1598, l'Édit de Nantes fait de Montpellier une place de sûreté pour les protestants tout en rétablissant les droits des catholiques. Guitard de Ratte entreprend une visite générale de son évêché et fait reconstruire les églises de Mireval, Pignan et Cournonterral. Mais ses adversaires s’acharnant à détruire la nuit ce qui est construit la journée, il est contraint de célébrer les offices dans des maisons particulières.
Un fervent catholique
A Montpellier, la plupart des églises ont été rasées en 1568. Les édifices restants sont gravement endommagés. En 1600, Henri IV autorise Guitard de Ratte à reprendre possession de l'église Notre-Dame des Tables (place Jean Jaurès) dont les voûtes sont effondrées mais dont les murailles ont été préservées pour ne pas affaiblir la tour de l'horloge de la façade. Mais lorsqu'on commence à démolir le ravelin (demi-lune) bâti sur le parvis de l’église, une foule hostile accourt et fait reculer le duc de Ventadour, l’émissaire du roi, et les chanoines. Seuls l’évêque et quelques gentilshommes ne se laissent pas intimider et refusent de quitter les lieux. C’est en vidant l’église de ses décombres qu’on découvre intacte la chapelle souterraine de Sainte-Madeleine. Guitard de Ratte la rend au culte en 1602 et y ordonne plusieurs prêtres.
Le 7 juillet 1602, alors qu’il se rend à Toulouse pour les affaires de son diocèse, il chute de son cheval attaqué par trois dogues et meurt quelques heures plus tard, à l’âge de 50 ans. Il est le dernier évêque de Montpellier inhumé dans la cathédrale de Maguelone, sous un gisant de marbre blanc.